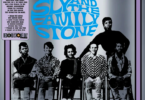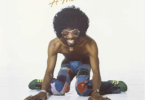Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius), le documentaire réalisé par Questlove sur Sly Stone, est diffusé sur la plateforme Hulu depuis le 13 février. Maxime Landemaine, auteur de la récente biographie L’imprévisible et incroyable Sly Stone, analyse pour Funk★U un film passionnant aux allures de documentaire définitif sur l’ascension vertigineuse et la déchéance brutale d’un géant de la musique moderne.
Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius), le documentaire réalisé par Questlove et diffusé sur Hulu depuis le 13 février, retrace le parcours de Sly Stone. Avec, à l’appui, de nombreuses images d’archives et les témoignages de membres de la Family Stone, ainsi que de journalistes et d’artistes comme Nile Rodgers, George Clinton, André 3000, D’Angelo, Q-Tip, Vernon Reid, Jimmy Jam et Terry Lewis, Ruth Copeland, l’auteur et universitaire Mark Anthony Neal et la réalisatrice Dream Hampton.
Ce film saisissant pose la question du fardeau pesant sur les épaules d’un artiste noir, incontournable au début des années 1970. Pendant plus d’une heure, il s’attarde sur les années glorieuses : les débuts de Sly en jeune loup, ambitieux, brillant, entreprenant. Étudiant modèle à l’université de Solano, buvant les paroles de son professeur de musique, puis DJ dans le vent sur la radio KSOL de San Francisco, captivant l’auditoire par son bagout. Producteur émérite chez Autumn Records, à l’aise avec tous les instruments, puis leader de la Family Stone, avec laquelle il grimpe à une vitesse confondante les échelons du succès, jusqu’à l’apogée de Woodstock, devant 500 000 personnes en août 1969…
Comme l’explique Mark Anthony Neal, quand un Afro-Américain parvient à ce niveau de notoriété, l’atmosphère devient irrespirable. Les médias guettent le moindre de ses mouvements. Sly Stone est sommé de s’exprimer dans les médias et de faire bonne figure. « Mon rôle sur cette terre est d’être un exemple et c’est dur. C’est un voyage solitaire », déplore-t-il dans l’émission de Mike Douglas en 1980. Dans une telle situation, des artistes blancs comme Bob Dylan ou John Lennon ont failli devenir fous, rendus paranoïaques par les attentes énormes pesant sur eux. Que dire, alors, d’un des premiers performeurs noirs pris dans ce maëlstrom ? Avant lui et Jimi Hendrix, aucun artiste Afro-Américain n’avait connu un tel engouement. Avec un sourire triste, D’Angelo ironise sur le poids de la célébrité. Tous ces rockers blancs qui ont déconné et mené une vie à cent à l’heure, goûtent une retraite bien méritée, comme Le Parrain, vivant dans l’opulence et choyés par leurs proches et cassant paisiblement leur pipe dans leur jardin. Mais pas les artistes noirs qui doivent payer leur succès au prix fort — Arrestation, prison, escroqueries, misère…
En l’absence de repères, Sly Stone va rapidement prendre les mauvaises décisions. Quand il quitte San Francisco pour emménager à Los Angeles en 1969, son mode de vie dégénère. Son addiction à la cocaïne, au PCP et aux tranquillisants et ses mauvaises fréquentations le transforment peu à peu. En 1980, la journaliste Maria Shriver lui pose la question sans ambages. « Il y a des gens dans ce pays qui essaient de parvenir au sommet. Vous, vous y arrivez et vous gâchez tout. Était-ce intentionnel ? ». Réponse abasourdie de Stone. « Non… ». Dans Sly Lives!, Dream Hampton explique que le meilleur moyen pour s’auto-détruire est bien sûr de sombrer dans l’alcool et la drogue et de rater ses engagements, mais aussi de couper les liens avec son entourage.
Sly Lives! se termine tristement. On sait qu’il n’y a jamais eu de second souffle dans la carrière de Sly. L’ultime disque de la Family Stone en 1983, un duo avec Jesse Johnson, quelques concerts erratiques et un come-back dégradant. Puis plus rien… Sly Lives! passe sous silence la vente de ses droits d’édition à Mijac (la société d’édition de Michael Jackson) dans les années 1980 et les agissements de son ancien manager entre 1990 et 2007, qui lui aurait siphonné toutes ses royalties. Source de tracas judiciaires et d’un état de dénuement douloureux au début des années 2010, quand Sly se retrouve presque à la rue. Néanmoins, le film ne le montre jamais sous un mauvais jour, à l’exception de quelques photos de lui âgé, dont une, inédite et poignante, vers la fin. Aucune image de son retour raté aux Grammys en 2007, de ses prestations gênantes dans les années 2000, ni de ses interviews à Crenshaw, quand il survit dans son camping-car… Il s’attarde en revanche sur la cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame en 1993, où Sly apparait tel un spectre hors du mur. C’est là la vraie cassure. Alors qu’il en a l’opportunité, il refuse de reformer la Family Stone pour une tournée lucrative. Il disparait ensuite pendant quinze ans.
Aujourd’hui, aux Etats-Unis et en Europe, la mention de son nom recueille généralement un silence poli. Il est à espérer qu’à l’avenir, les gens reconnaitront Sly Stone à sa juste valeur. Le mieux est de fermer les yeux sur ses années de perdition et de se rappeler son impact durant son âge d’or. N’est-ce pas Mark Anthony Neal qui le décrit le mieux dans le documentaire ? A jamais, il restera le « black Elvis », une légende.
Maxime Landemaine
Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius), diffusé sur la plateforme Hulu depuis le 13 février.